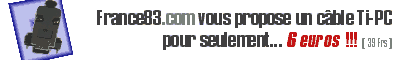Consultation du fichier Macro.83p
Vous pouvez télécharger ce fichier en cliquant sur le lien ci-dessous:
Utilisateurs de Netscape, après avoir cliqué sur ce lien,
une page de type texte avec de nombreux caractères peut s'afficher. Cliquez alors sur
Fichier/Enregistrez sous. Sélectionnez un dossier et tapez ".83p" puis validez.
Votre fichier est alors téléchargé sur votre disque dur.
Contenu du fichier Macro.83p
Description: macro
Texte:
04/02/2005 Macroéconomie
Chapitre1
LES GRANDES FONCTIONS
MACROECONOMIQUES
Section1 : la fonction de consommation Keynésienne
1)La fonction de consommation
Dans la fonction de demande d’un bien particulier, les classiques et le bon sens privilégie la relation prix/quantité demandée. La demande d’un bien est fonction décroissante du prix. Nous avons donc une vérité microéconomique. Keynes, qui résonne au niveau globale (macroéconomie) relie la demande de consommation globale au revenu global. Lorsque le revenu augmente, la consommation augmente aussi mais pas du même montant. La consommation est une fonction croissante du revenu. On rend généralement compte de cette fonction de consommation par l’équation et le graphe suivant :
C=cY+C0 de la forme y=ax+b
Avec : C=consommation finale
c=propension marginale à consommer (0
Y=revenu global
C0=consommation incompressible ou autonome
Cette fonction est dite affine, c'est-à-dire une fonction linéaire qui ne passe pas par l’origine.
La relation entre consommation et revenu s’exprime par deux propensions :
1-propension moyenne à consommer ou rapport de la consommation totale au revenu global :
PMC=C/Y
2-propension marginale à consommer ou rapport de la variation de consommation à la variation correspondante du revenu :
PmC=?C/?Y=c (pente de la courbe)
C’est la fraction du revenu nouveau consacré à la consommation.
Caractéristiques de ces deux propensions :
?la PMC est une fonction décroissante du revenu. Lorsque le revenu augmente, la PMC diminue.
C=cY+C0
C/Y=c+C0/Y
Si Y augmente, c=constante, donc C0/Y diminue.
?La PmC est constante et elle est inférieure à la PMC.
2) La fonction d’épargne
L’épargne étant définie comme l’excès de revenu sur la consommation, c'est-à-dire : S=Y-C
La fonction d’épargne sera le complément à l’unité de revenu de la fonction de consommation.
S=sY-S0 avec : S=épargne globale
S=propension marginale à épargner
S0=épargne négative ou désépargne.
Si on a C=0.8Y+12
Alors, on a S=0.2Y-12
?C+S=Y
Relations :
1- S/Y propension moyenne à épargner ou taux d’épargne.
EB/RDB=épargne brut/revenu disponible brut
2-?S/?Y=s propension marginale à épargner.
La PMS est une fonction croissante du revenu.
La PmS est constante et elle est supérieure à la propension moyenne à épargner.
3) Vérification :
?A court terme
L’étude de séries temporelles courtes semble confirmer l’hypothèse Keynésienne.
Ex : France 1965-1975 ; les observations mettant en relation le RDB des ménages et la consommation donne un nuage de points ajusté par la droite d’équation : C=0.82Y+12.5
?A long terme
L’étude de séries temporelles longues semble confirmer une autre version possible de la fonction de consommation Keynésienne représentée par une fonction linéaire d’équation C=cY
Ex : Etats-Unis 1896
Etude de Simon KUTZNETS donne la droite d’équation C=0.86Y.
Section 2 : Apport post Keynésien
1) L’effet de démonstration de DUESENBERRY :
DUESENBERRY considère que les biens sont de signes, des symboles et ne sont donc pas seulement consommés pour eux-mêmes. Les objets perdent l’essentiel de leur fonction pratique pour s’organiser en système symbolique. Il met en évidence un effet de démonstration ou d’imitation. C'est-à-dire que les agents économiques du groupe inférieur auront une propension moyenne à consommer plus forte que les agents économiques du groupe supérieur parce qu’ils cherchent à imiter la consommation du groupe supérieur sans en avoir le revenu. La croissance du revenu au cours du temps n’entraîne pas de diminution de la PMC. La fonction de consommation est alors de la forme :
C=cY
Ce qui signifie que la consommation est proportionnelle au revenu et que la propension à consommer est constante.
C/Y=c=constante.
Ceci n’est vrai qu’en régime de taux de croissance régulier, c'est-à-dire à peu près constant. En revanche, si il y a variabilité du taux de croissance, la consommation n’est plus proportionnelle au revenu.
2) La fonction de consommation différenciée par groupes sociaux :
On fait une analyse en coûts instantanés des différents niveaux de consommation des ménages selon leur niveau de revenus. Il y a une diminution de la propension à consommer avec l’augmentation du revenu. Le recourt à une telle fonction a été adopté par beaucoup de modèles économétriques, notamment en France, le modèle métrique.
3) L’influence du passé, l’effet de cliquet de DUESENBERRY :
Cliquet = sorte de taquet mobile autour d’un axe servant à empêcher une roue dentelée de tourner dans le sens contraire à son mouvement.
Ici, parler d’effet de cliquet signifie qu’il n’y a pas de retour en arrière en matière de consommation. Il y aurait irréversibilité dans le temps des décisions de consommation, c'est-à-dire si le revenu baisse, la consommation ne baisse pas. Par un effet de cliquet, les consommateurs réagissent à la baisse du revenu par une hausse de la propension à consommer pour préserver leur niveau de vie. Donc la consommation dépend à la fois du revenu courant et du revenu le plus élevé dans le passé.
Ct=c (Yt+Ymax)
En somme, dans une optique Keynésienne mais en inversant le résonnement conjoncturel de Keynes, on pourrait dire non pas que la propension à consommer décroît quand le revenu croît, mais que la propension à consommer croît quand le revenu décroît. Ainsi, la variabilité de la propension à consommer est un stabilisateur à la baisse (rôle anticrise) plutôt qu’un déstabilisateur à la hausse (facteur de crise).
?Version douce de l’effet de cliquet :
On peut présenter une version plus douce de l’effet de cliquet qui serait en même temps plus proche de la fonction de la version traditionnelle de la fonction de consommation Keynésienne. La consommation baisse avec la baisse du revenu mais pas autant. On envisage ici une variabilité du taux de croissance économique.
1- En période de récession, la consommation diminue moins fortement que le revenu. Les ménages souhaitent maintenir leur consommation en réduisant leur épargne.
2- En période de reprise, la consommation s’élève plus lentement que le revenu. Les ménages reconstituent leur épargne.
3- En période de croissance forte et régulière, la consommation redevient proportionnelle au revenu.
En taux de croissance En période de reprise En période de récession
1987
1988 Ecart-poids du passé
1992
1993 Ecart-poids du passé
Effet de cliquet
Pouvoir d’achat du revenu disponible 0.5 3.4 2.9 2.1 0.6 -1.5
Consommation des ménages 2.3 2.7 0.4 1.2 0.4 -0.8
En période de reprise, la consommation ne croît pas aussi vite que le revenu.
En période de récession, la consommation ne décroît pas aussi vite que le revenu.
Graphique :
-1° période : la consommation diminue moins vite que le revenu? les ménages tirent sur leur épargne.
-2° période : le revenu augmente plus vite que la consommation.
-3° période : la consommation devient proportionnelle au revenu.
On peut donc dire que la consommation connaît une évolution moins heurtée que le revenu.
Tout se passe comme si la consommation était soumise à une sorte de force d’inertie.
Parler de force d’inertie, c’est faire référence au poids du passé.
Tableau :
L’influence du passé en matière de consommation peut être représentée par la consommation de la période précédente, ce qui nous donne une fonction de consommation de ce type :
Ct=cY+?Ct-1+C0
Chapitre 2
LA FONCTION D’INVESTISSEMENT
Définition : l’investissement est la valeur des biens et services durables acquis par les unités de production pour être utilisés pendant plus d’un an dans le processus de production
.
Double rôle de l’investissement :
-constitue une composante importante de la demande globale
D=C+I (avec D=demande globale) ? Y=C+I (avec Y=offre globale)
A ce titre, il exerce une influence sur la production et l’emploi à court terme.
-constitue une accumulation de capital et de ce point de vue augmente la production potentielle et la croissance économique à long terme. L’investissement est alors l’objet d’étude des théories sur la croissance.
Détermination de l’investissement :
Les anticipations d’entrepreneurs, les profits actuels ou anticipés, les prix relatifs des facteurs de production avec substitution possible du capital au travail, le stock de capital existant, la politique économique, le taux d’intérêts…
Lorsque KEYNES veut définir « l’incitation à investir », il le fait en parlant de ces deux déterminants : l’efficacité marginale du capital (qui désigne le taux de profit anticipé) et le taux d’intérêts.
Les termes de KEYNES nous conduisent par extension à deux des principes de l’investissement : la demande anticipée et le coût du capital.
1) Les déterminants de l’investissement
A- Investissement (I) et taux d’intérêts (i)
I=f (i)
A propos de l’influence du taux d’intérêts sur l’investissement, on passe facilement de la microéconomie à la macroéconomie.
La demande globale de l’investissement résulte d’une transposition de l’analyse de la décision d’investissement au niveau de la firme.
1- Au niveau microéconomique
Soit une firme ayant plusieurs projets d’investissement classés par taux d’intérêts décroissants
La base correspondant à chaque projet est variable comme l’est le montant d’investissement de chaque projet.
La ligne supérieure et discontinue représente la fonction d’investissement de la firme. Elle rend compte de la rentabilité de chacun des projets. Pour une rentabilité i0, la firme met en œuvre les 3 projets A, B, C qui ont une rentabilité supérieure à i0. Pour une rentabilité i1, la firme ne met en œuvre que les projets A et B.
L’investissement de la firme est donc une fonction décroissante du taux d’intérêt.
2-Au niveau macroéconomique
La fonction d’investissement macroéconomique sera représenté par une courbe continue compte tenu du nombre très élevé de firmes et de projets.
La fonction globale d’investissement est une fonction décroissante du taux d’intérêt.
Ce qui compte n’est pas le taux d’intérêt nominal mais le taux d’intérêt réel qui représente le coût réel du crédit.
Taux d’intérêt réel = taux d’intérêt nominal – taux d’inflation
(=monétaire)
En A, le taux d’intérêt est faible, l’investissement global I est élevé. En effet, les entreprises qui empruntent le font à taux d’intérêt faible et peuvent donc mettre en oeuvre des projets d’investissement à faible taux de profits, c'est-à-dire une grande quantité de projets d’où I élevé.
En B, le taux d’intérêt réel est élevé, I est faible. En effet, les entreprises qui empruntent le font à taux d’intérêt élevé et ne peuvent donc mettre en œuvre que les projets d’investissement les plus rentables à taux de profit élevé, c'est-à-dire une faible quantité d »e projets d’où un investissement global I faible.
Toute baisse du taux d’intérêt suscite la mise en œuvre de projets d’investissement additionnel devenus rentables et une hausse provoque en revanche la non réalisation de projets d’investissement devenus non rentables.
Si la liaison décroissante entre investissement et taux d’intérêt est très généralement admise, la sensibilité de l’investissement au taux d’intérêt est en revanche très discutée.
Selon que cette sensibilité sera considérée comme élevée (cas classique), ou faible (cas keynésien), la liaison rentre investissement et taux d’intérêt aura plus ou moins d’importance.
Si il y a faible sensibilité d’investissement au taux d’intérêt (ou relative inélasticité), l’autre déterminant de l’investissement qui est le revenu global prend une grande importance.
B- Investissement et revenu global
Le principal déterminant de l’investissement n’est peut être pas le taux d’intérêt mais le revenu global ou plus exactement les anticipations faites par les entrepreneurs sur la période future.
Dans la mesure où le prix des marchandises peut être considéré comme déterminé par les entreprises elles mêmes (régime monopolistique) ou imposé par le marché (régime concurrentiel), les anticipations des entrepreneurs porteront exclusivement sur la seule quantité vendue. C’est donc la demande anticipée qui sera le déterminant de l’investissement.
On peut aussi parler de profit anticipé ou de taux de profit anticipé.
Comment se font les anticipations ?
La théorie économique prenant en compte un nombre rationnel d’agents économiques va considérer que les entrepreneurs en moyenne fondent leur anticipation sur les résultats passés plus ou moins infléchis selon la conjoncture.
Les anticipations sont dites rationnelles si les agents économiques fondent leur choix en utilisant toute l’information disponible et utile.
Leurs précisions sont rationnelles mais non parfaites.
En réalité, l’anticipation des entrepreneurs est quelque chose qui relève peut être davantage du flair des entrepreneurs (« animals spirits » J. ROBINSON) que de la raison.
Les théoriciens du circuit, B SCHMITT, parlent plus volontiers de demande imaginaire que de demande anticipée comme pour rendre compte au niveau du langage de quelque chose qui est difficilement réductible au rationnel classique. En ce sens, tout investissement est fondamentalement un pari sur l’avenir.
Concrètement, l’analyse à venir de la conjoncture à venir, c'est-à-dire hausse de la demande anticipée, ce qui incite les entrepreneurs à accroître leur capacité de production pour faire face à l’expansion de la demande.
Graphiquement, on rend compte habituellement de cette incidence de la demande anticipée sur l’investissement en déplaçant vers la droite en cas d’expansion anticipée ou vers la gauche en cas de récession anticipée, la courbe de demande d’investissement précédente fonction du taux d’intérêt.
Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à taux d’intérêt constant, les projets d’investissement seront plus nombreux pour répondre à l’expansion de la demande.
A chaque taux d’intérêt, plus de projets permettront de couvrir le coût d’emprunt des fonds.
Donc quelque soit le taux d’intérêt, l’investissement souhaité augmentera donc le déplacement de la courbe vers la droite.
Conclusion
L’investissement n’est donc plus principalement fonction décroissante du taux d’intérêt, mais aussi fonction croissante du revenu global anticipé. Les fonctions d’investissement deviennent alors :
I = f (i, y)
La courbe d’investissement n’est donc plus unique par rapport à la pluralité des courbes d’investissement. Elle doit être construite selon le niveau attendu du revenu global.
La vraie synthèse ne consiste donc pas à additionner les déterminants de l’investissement, mais à déceler la ou les variables majeurs et la ou les variables mineurs.
La variable explicative majeur de l’investissement sera plutôt le taux d’intérêt chez les néoclassiques, et plutôt le revenu global anticipé chez les keynésiens. Empiriquement, on distingue une évolution assez semblable de l’investissement et du revenu global.
Ex : évolution parallèle du taux de croissance de la FBCF et du PIB en France de 1960 à 1980.
Ex : évolution semblable également du taux d’investissement des sociétés hors GEN (SNCF, EDF…) et du taux de croissance du PIB de 1970 à 1995.
Ce double constat empirique effectué sur l’économie française tend à accréditer l’idée de la détermination essentielle de l’investissement par le revenu global.
Enfin, si les théoriciens de l’économie accordent de l’importance au taux d’intérêt comme déterminant de l’investissement, il est frappant de constater que les praticiens de l’économie insistaient davantage sur l’existence de débouchés dans le passage à l’acte d’investissement.
2) Un actif de la macroéconomie : le multiplicateur
1- Origines du concept
C’est lors de la grande dépression que KAHN invente le multiplicateur d’emplois en 1931.
KEYNES l’adopta sous la forme de multiplicateur d’investissement (1936) mais on pourrait généraliser le mécanisme sous l’appellation de multiplicateur de revenu. C’est en effet le revenu qui se multiplie.
Le problème est de lutter contre la dépression de l’activité économique et le sous emploi qui l’accompagne.
Devant cette carence de l’économie de marché, incapable d’assurer par elle même le plein emploi, KEYNES va légitimer la politique économique de l’Etat dont l’objet est de combattre ce fléau économique et social qu’est le chômage.
Le multiplicateur d’investissement est l’un des moyens de cette politique.
2- Le processus de multiplication
Supposons la production d’un bien d’équipement additionnel privé ou public. Cette production nécessite une création de revenus distribuée aux facteurs de production qui créent le bien en question et méritent donc rémunération.
Ces revenus nouveaux vont être dépensés, c'est-à-dire consommés ou épargnés selon les propensions à consommer ou à épargner des titulaires de revenus. La fraction de revenus nouveaux consacrées à la dépense est d’abord une demande de biens de consommation qui provoque pour pouvoir être satisfaite une relance de la production de biens de consommation.
Cette production nouvelle de biens de consommations créer une deuxième vague de revenus nouveaux pour les facteurs de productions qui fabriquent ces nouveaux biens de consommation.
Cette vague se partage elle aussi en dépenses et épargne, c'est-à-dire en demande de biens de consommation et demande d’épargne.
Cette deuxième demande de biens de consommation nécessite pour être satisfaite une production supplémentaire de biens de consommation qui créée une troisième vague de revenu…
3- Données chiffrées
L’ensemble des revenus créés sera ?Y + ?Y’ + ?Y’’… = 100 + 80 + 64…
CE processus est sans fin si on accepte d’aller jusqu’à l’infiniment petit.
Conceptuellement le processus lorsque la somme des fuites = l’injection initiale.
? ?S = ??I
Concrètement, au bout de 6 périodes le processus de multiplication est déjà épuisé à 75%.
4- La formule de multiplication
Les accroissements successifs de revenus sont illustrés par la chaîne suivante :
100 + 0.8 (100) + 0.8 (0.8 * 100) + …
100 + 0.8 (100) + 0.8² (100) + 0.83 (100) + …
C’est la somme d’une suite géométrique de premier terme 100 et de raison c = 0.8.
Cette série est dite convergente et tend vers une limite qui est :
? ?Y = 100 (1/1-c) = 100 (1/1-0.8) = 500
Le multiplicateur est le rapport entre la variation du revenu global ?Y et la variation de l’injection initiale ?I.
Soit : ?Y / ?I = 500 / 100 = 5
Le multiplicateur est généralement représenté par k :
K = 1 / (1-c) = 1 / (1-0.8) = 5
?Y = k.?I
Y = C + I
C = Y + C0 équation d’équilibre
I = I0
Y = cY + C0 + I0
Y – cY = C0 + I0
Y (1 – c) = C0 + I0
Y = I0 (1 / 1-c)
Y = (1 / 1-c) I0 ? Y = k.I0 ou ?Y = k.?I0
[ Langue: fr - Auteur: PEC (sup) ]
Utilisation du fichier sur une calculatrice
Pour pouvoir lire ce fichier sur une calculatrice Ti82, Ti83, ou Ti83+, vous devez télécharger les
deux programmes ci-dessous:
- Si vous possédez une Ti83 ou une Ti83+:
- Si vous possédez une Ti82:
Suivez à présent ces étapes :
- Si vous possédez une Ti83 ou une Ti83+:
- Décompressez les fichiers ion.zip et txtviewAV.zip à l'aide d'un utilitaire du type Winzip.
- Ouvrez votre logiciel de transfert Ti-PC, puis connectez votre cable (si vous n'en possédez pas, vous pouvez
en acquérir un à partir de 6 euros sur les enchères de france83.com: voir la pub en haut de la page).
- Envoyez les fichier Ion.83g (ou ion.8xg si vous avez une Ti83+), Txtview.83g (ou Txtview.8xg si vous avez une Ti83+) et Macro.83p sur votre calculatrice.
- Sur votre calculatrice, lancez le programme nommé "ION", un programme nommé "A" est généré.
- Lancez le programme nommé "A". "Textview" apparait alors dans le menu qui s'affiche. Cliquez dessus.
Vous voyez un nouveau menu s'ouvrir. La description du programme que vous venez de télécharger y apparait.
Cliquez dessus. Votre texte s'affiche sur l'écran !
- Si possédez une Ti82:
- Décompressez les fichiers crash.zip et txtview82.zip à l'aide d'un utilitaire du type Winzip.
- Ouvrez votre logiciel de transfert Ti-PC, puis connectez votre cable (si vous n'en possédez pas, vous pouvez
en acquérir un à partir de 6 euros sur les enchères de france83.com: voir la pub en haut de la page).
- Envoyez les fichiers Crash.82b (attention ceci effacera toutes les données enregistrées sur votre calculatrice!) puis TxtView.82p et Macro.83p sur votre Ti
- Lancez le programme nommé "Crash". "Textview" apparait alors dans le menu qui s'affiche. Cliquez dessus.
Vous voyez un nouveau menu s'ouvrir. La description du programme que vous venez de télécharger y apparait.
Cliquez dessus. Votre texte s'affiche sur l'écran !
Options relatives à textview
Une fois les étapes précédentes réalisées, vous voilà sur le programme textview.
Ce programme propose plusieurs options qui vous permettent de lire le fichier que vous venez de télécharger.
Voici les boutons de votre calcultrice à presser pour obtenir l'action indiquée:
- (quand vous êtes sur ION ou sur CRASH (Ti82), cliquez sur [MODE] pour quitter ION)
- Quand vous êtes dans le menu principal de Textview:
- [flèche "haut"] : faire monter le curseur de sélection
- [flèche "bas"] : faire descendre le curseur de sélection
- [flèche "droite"] : change de page (s'il y'a plus de 9 fichiers sur la calculatrice)
- [CLEAR] : retourner vers ION
- Quand vous lisez un fichier avec textview:
- [flèches] : faire défiler le texte sur l'écran
- [DEL] : aller en haut de la page
- [STAT] : aller en bas de la page
- [2nd] + [flèche "gauche"] : aller à gauche de la page
- [2nd] + [flèche "droite"] : aller à droite de la page
- [TRACE] : retour au début du texte
- [GRAPH] : aller à la fin du texte
- [MODE] : retour à la ligne automatique
- [X,T,0] : afficher le texte en plus petit
- [Y=] : inverser les couleurs de l'écran
- [CLEAR] : retour vers le menu principal de Textview
- IMPORTANT: ne pressez jamais [2nd], [ON] pour éteindre votre calculatrice alors que vous êtes
encore sous txtview, sans quoi votre calculatrice "plantera" et toutes les données enregistrées en mémoire seront perdues !
TTT, Text To Ti, est un programme réalisé par guillaume renard (france83.com) adapté
du logiciel calctext de kouri (encore merci kouri!). Tous droits réservés à leurs auteurs. Les images et les textes du site sont
protégés par copyright. © Guillaume Renard - 2002. Ti82, Ti83, Ti83+ sont des
marques déposées par le groupe Texas Instrument. France83.com,
le logiciel TTT, Text To Ti, et son auteur ne sont, en aucun cas, affiliés ou partenaires avec le groupe Texas Instrument.
|
|
|